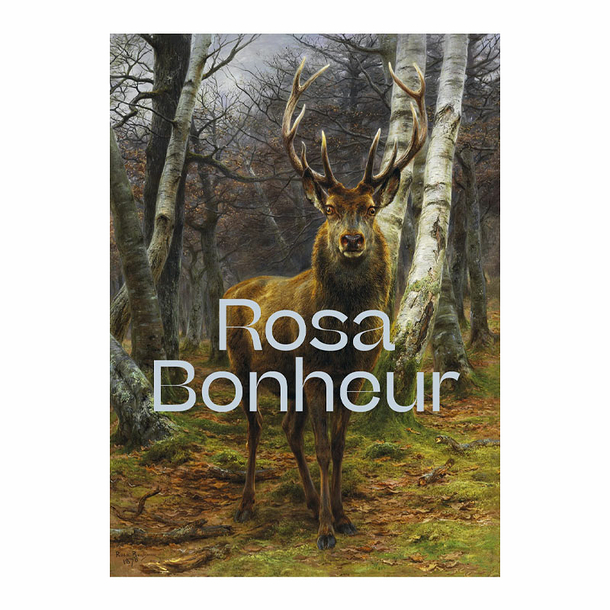Caroline Culp (Vassar College, Poughkeepsie, NY, États-Unis)
Béhémoths : art et économie dans les tableaux du XIXe siècle de Caroline Clowes
S’il existe une tradition riche et dynamique de la peinture animalière dans l’histoire de l’art américain du XIXe siècle, elle est en grande partie directement liée à la chasse, activité ouvertement masculine. Ainsi, les spécialistes ont appréhendé les œuvres d’artistes tels que Winslow Homer et John James Audubon du point de vue de la défense de la cause animale et de l’évolution des mouvements pour les droits des animaux. Or, les mesures interprétatives de cet ordre ne s’appliquent pas à l’œuvre de Caroline Clowes (1838-1904), l’une des premières artistes féminines professionnelles de la vallée de l’Hudson, dans l’État de New York. Bien qu’elle soit peu connue aujourd'hui, Clowes s’est forgé une réputation internationale au XIXe siècle grâce à ses charmantes scènes de la vie quotidienne agricole dans l’Amérique rurale. L’étude inédite de sa carrière offre une toute nouvelle perspective sur des débats qui remontent à plusieurs décennies autour de la peinture animalière, de son statut sexospécifique et des femmes peintres professionnelles dans l’Amérique du xixe siècle.
Cet article porte essentiellement sur les peintures et les dessins de Clowes représentant son sujet dominant : le bétail. À partir d’archives constituées récemment et composées de correspondances familiales, d’objets éphémères et d’œuvres d'art provenant de la bibliothèque de la Société historique du comté de Dutchess, et au regard de l’histoire de l’élevage agricole dans la région de la vallée de l’Hudson, il postule que le succès de Clowes reposait sur sa capacité à se frayer un chemin dans le marché local actif de la peinture animalière avec une grande perspicacité. En mettant en avant la pratique auparavant marginalisée qu’était la peinture de la main d’une femme dans l’Amérique rurale, cet article s’intéresse au professionnalisme féminin en dehors des centres artistiques de Paris, Londres et New York. Bousculant les histoires actuelles de l’art américain, il propose une vision approfondie de la manière dont les artistes féminines atteignaient le succès dans le contexte de la société du XIXe siècle et de ses contraintes.
Clémence Rinaldi (Sorbonne Université, Paris)
Peintresses et sculptrices animalières dans les expositions féminines à la fin du XIXe siècle
« D’ordinaire, la femme, peintre ou sculpteur, ne fait pas un gros effort d’imagination quand elle veut peindre ou sculpter. Elle prend, à la portée de sa main, un tas de pivoines ou de roses ; elle copie, d’un pinceau mièvre ou d’un ébauchoir minutieux, des museaux de petits chats et des derrières de petits chiens… » (Édouard Lepage, Une page de l’histoire de l'art au xixe siècle. Une conquête féministe : Mme Léon Bertaux, Paris, J. Dangon, 1911, rééd. Saint-Michel-de-Chavaignes, Soleil en livres, 2009, p. 193). Jugées triviales, voire enfantines, au même titre que les natures mortes réalisées par des femmes, leurs représentations d’animaux sont systématiquement associées au concept essentialisant d’art « féminin » et suscitent des débats sur les capacités d’imagination et d’originalité des créatrices. La question de la noblesse des animaux représentés (majestueux) ou de leur trivialité (animaux de compagnie, basse-cour) mais également celle de la proportion du genre animalier au sein des expositions féminines constituent des points de clivage entre les différentes sociétés d’artistes femmes, entre celles accusées d’amateurisme et celles reconnues comme professionnelles. Tandis que les salons de l’Union des femmes peintres et sculpteurs, où les représentations d’animaux domestiques abondent particulièrement, canalisent la plupart des critiques sur l’amateurisme, dans les expositions des sociétés qui lui succèdent, le genre animalier est présent en plus faible proportion et les animaux représentés plus diversifiés. À travers l’analyse des peintures et sculptures animalières exposées aux salons féminins à la fin du xixe siècle, nous interrogerons les débats qui entourent ces pratiques, intrinsèquement liées aux stéréotypes de genre sur l’art « féminin ».
Annemarie Bilclough (Victoria and Albert Museum, Londres)
Beatrix Potter : l’attraction de la nature
Les illustrations et les histoires de Beatrix Potter (1866-1943) captivent des millions d’enfants dans le monde, mais ses célèbres personnages animaliers ne sont qu’une partie de son héritage. Helen Beatrix Potter est née à Londres en 1866. Célibataire jusqu’à ses 47 ans, elle restera dans sa maison familiale jusqu’à son mariage et son installation en exploitation agricole. Issue de la classe moyenne aisée, elle n’est pas obligée de travailler pour gagner sa vie ; au lieu de cela, elle s’attache à trouver un sens à son existence par d’autres moyens.
Dès son jeune âge, elle grandit auprès de différents animaux domestiques. Son journal intime et ses correspondances indiquent qu’elle étudie les amphibiens et pratique la taxidermie. Avec son frère, elle crée et organise des collections d’os et de spécimens, dont des insectes, des œufs d’oiseaux et des fossiles. Potter aime étudier le comportement des animaux, et ses connaissances en la matière vont également l’inspirer dans ses histoires et ses illustrations.
Potter est également une scientifique née. Dans sa vingtaine, elle pratique la microscopie et sillonne les musées qui se trouvent près de sa maison familiale pour étudier les insectes et les fossiles et y rencontrer des spécialistes. Ses illustrations indiquent une approche consciencieuse de la science. Potter critique la tendance des experts à se sur-spécialiser, mais elle s’immergera elle-même dans l’étude de la mycologie en expérimentant la germination de spores. Son journal et ses lettres à un confrère mycologue amateur offrent un aperçu de la façon dont son sexe féminin a entravé son accès à l'information et ses opportunités d’échanges scientifiques. Ils attestent ses tentatives de collaborer avec des scientifiques aux Jardins botaniques royaux de Kew (Londres), et sa difficulté à être prise au sérieux.
Anna Orton-Hatzis (City University of New York)
Immortaliser les lions du Cap disparus et les lions de Barbarie en voie de disparition : Enquête sur le discours du XIXe siècle sur l'extinction, dans les peintures de lions de Rosa Bonheur.
Dans son article intitulé "Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grandes femmes artistes ? » Linda Nochlin positionne Rosa Bonheur, peintre animalière du XIXe siècle, comme l'artiste féminine exemplaire qui a surmonté les pratiques d'exclusion de l'Académie française. À l'époque, la thèse de Nochlin était révolutionnaire. Cependant, près de cinquante ans plus tard, Bonheur reste inextricablement liée à ce récit de l'exceptionnalisme féminin. Bien que certains historiens de l'art aient rendu les enquêtes sur le genre de Bonheur pertinentes pour l'interprétation de son art, ils n'en ont pas tenu compte. Cet article revisitera les œuvres de la plus grande artiste animalière à la lumière de son sujet. Plus précisément, on étudiera trois des peintures de Rosa Bonheur représentant des lions - Lion (n.d.), Lion dans un paysage de montagne (1880) et Lion dans un paysage de montagne (1880) ainsi que le discours naissant sur l'extinction des animaux dans la seconde moitié du XIXe siècle. Avant le XIXe siècle, le concept d'extinction des animaux représentait un défi important pour le système judéo-chrétien. À partir du début du siècle, les découvertes archéologiques de fossiles et leur étude ont permis de mettre en évidence l'importance de l'extinction des animaux. Paradoxalement, ce changement d'attitude des scientifiques à l'égard de l'extinction coïncide avec une époque où l’actions de l’homme a mis en danger un grand nombre d'espèces. Cette présentation soulignera le rôle de Bonheur dans l'immortalisation des espèces en voie de disparition et sa contribution au discours naissant sur le lion.
Francesca Posca (université Bordeaux-Montaigne)
Vivre des animaux. Julie Charpentier (1770-1845), sculptrice et préparatrice en zoologie au Muséum national d’histoire naturelle de Paris
Dans la perspective du projet pédagogique révolutionnaire, le Muséum national d’histoire naturelle de Paris avait été fondé en 1793 afin d’intégrer de nouvelles collections et disciplines. Pour les artistes, le Muséum est devenu un lieu de formation en botanique, en anatomie et en myologie des animaux. Une femme, la sculptrice Julie Charpentier, tirera profit des connaissances acquises dans une perspective de professionnalisation et mettra ses nouvelles compétences au service des pratiques de conservation des animaux. Élève de Pajou, Julie Charpentier est une des rares sculptrices qui exposent au Salon entre la Révolution et la Restauration. Toutefois, les stéréotypes de genre persistent, en particulier dans le domaine de la sculpture. Ne parvenant pas à vivre de son art, Julie Charpentier commence à s’intéresser à la taxidermie et, en 1801, offre ses services au Muséum en envoyant quelques animaux naturalisés. Durant les années qui suivent, elle se consacre à la taxidermie et les enseignements des naturalistes lui permettent de se professionnaliser dans cette pratique. Toutefois, bien qu’elle ait travaillé pendant vingt ans au Muséum, elle n’y devient officiellement employée qu’à l’âge de 56 ans. Notre étude s’appuiera sur les collections et les archives inédites du Muséum, avec une attention particulière aux commandes et aux procès-verbaux. Ces éléments nous permettront d’analyser les travaux réalisés par l’artiste durant cette période et de comprendre comment son accès à la connaissance des animaux lui a permis de se professionnaliser et de s’affirmer au sein d’une pratique novatrice qui n’appartenait pas nécessairement au domaine artistique et qui n’était pas dévolue aux femmes.
Erin Corrales-Diaz (Toledo Museum of Art, États-Unis)
Mystérieuse nature : le genre et le mouvement taxidermiste américain
La naturaliste américaine Martha Maxwell (1831-1881) a inventé une méthode de taxidermie qui donne à ses spécimens l’apparence d’être vivants au sein de tableaux élaborés représentant leur habitat naturel. Au lieu de coudre des peaux avant de les remplir de paille, ce qui donne souvent un résultat peu naturel, voire parfois comique, Maxwell met au point une méthode consistant à recouvrir des structures moulées d’argile ou de plâtre de Paris pour recréer les muscles et les os, puis à étendre la peau sur le support. Pour Maxwell, présenter les animaux de manière incroyablement réaliste est un hommage personnel aux animaux qu’elle adore. Mais ce besoin de réanimer les morts correspond par ailleurs précisément au scepticisme de l’Amérique d’après la guerre de Sécession à l’ère des duperies de P.T. Barnum. Alors que les Américains comprennent les fausses pièces de taxidermie de Barnum, à l’image de sa « Sirène des Fidjis » (mélange entre un singe et un poisson), appréciant le spectacle et le décodage du mécanisme de l’illusion, les tableaux et les montages de Maxwell s’approchent trop près de la réalité pour les mettre à l’aise. L’angoisse générée par le fait de brouiller la frontière entre l’animé et l’inanimé a suscité des remarques sensationnelles et une incrédulité chez les spectateurs confrontés à cette représentation animalière. Même si celle-ci n’était pas vouée à tromper le spectateur, l’illusion taxidermique de Maxwell éclaire ses expériences en tant que naturaliste et soulève des questions sur les limites sexospécifiques historiques qui jalonnent la communauté scientifique. Cet article met en lumière les pratiques novatrices de Maxwell rapprochant taxidermie et habitat comme une stratégie subversive pour rendre ce qui nous est familier étrange et révolutionner la façon dont les Américains perçoivent l’animal et la femme dans un monde patriarcal.
Vanessa Bateman (Maastricht University, Pays-Bas)
Martha Maxwell, Rosa Bonheur et les femmes qui jouent avec les frontières entre art et science, domestique et sauvage
Cet article présente l’œuvre de Martha Maxwell (1831-1881), naturaliste et taxidermiste américaine autodidacte qui a modernisé la taxidermie et la présentation des habitats animaliers dans les années 1870. Bien qu’elles ne se soient jamais rencontrées, Maxwell a été comparée à Rosa Bonheur (1822-1899) de son vivant au titre de leurs qualités esthétiques et leurs idéaux féministes communs. Visuellement, leurs œuvres étaient proto-cinématiques, illustrant les mouvements, les comportements et les habitats des animaux sous forme de tableaux taxidermiques et de peintures grands formats. Maxwell et Bonheur s’attachaient toutes deux à créer des représentations scientifiquement fidèles de leurs sujets, œuvraient en faveur de la cause animale et s’affirmaient au sein de leur discipline en construisant soigneusement leur image publique grâce à l’art du portrait. Par ailleurs, leur relation aux animaux s’affranchissait des frontières entre le sauvage et le domestique : Maxwell a appris seule à chasser des animaux sauvages dans le Colorado pour remplir sa maison et son musée de spécimens, et les sujets que peignait Bonheur étaient souvent des animaux sauvages et domestiques qui vivaient dans sa ménagerie ou décoraient sa maison et son atelier. Tout en abordant les parallèles entre les pratiques de Maxwell et de Bonheur, cet article s’attachera à situer l’œuvre de Maxwell dans le contexte global des femmes exerçant dans le domaine des sciences naturelles à la fin du xixe siècle. L’animal était de plus en plus présent dans les intérieurs victoriens de classe moyenne, sous forme d'image, d’objet décoratif, de matière et de compagnon. Une reproduction de l’un des tableaux de Bonheur pouvait par exemple être installée à côté d’une vitrine animalière conjuguant sciences amateurs et arts manuels. Maxwell et Bonheur illustrent la manière dont les femmes se distinguaient dans les domaines essentiellement masculins de l’art et des sciences, tout en réimaginant les relations homme-animal comme mutuelles, forme d’antidote aux récits masculins opposant l’homme au monde naturel.
Zoé Marty (musée d'Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole)
Profession(s) : peintre, sculptrice, dompteuse et chasseresse
Au XIXe siècle, le succès des ménageries et des cirques ambulants favorise les possibilités des rencontres entre artistes et animaux féroces et par extension les récits qui les mettent en scène. La discipline du domptage se développe particulièrement à partir de 1830 à travers les figures telles qu’Ellen Bright « Queen of the Lions », Claire Héliot ou Nouma Hawa. Si la fascination qu’elles suscitent auprès du public est fondée sur la démonstration de la domination que peut exercer l’humain sur la nature, elle ne dépend pas des mêmes atouts, que l’on soit dompteur ou dompteuse. De même que la perception et la qualité des chasseresses ne répondent pas aux mêmes critères que ceux invoqués pour leurs pendants masculins. Nous verrons comment l’archétype de la dompteuse et celui de la chasseresse, plus ancien, ont pu constituer des modèles dans la construction de la notoriété de figures aussi différentes que l’actrice Sarah Bernhardt, la peintre Rosa Bonheur, la danseuse La Goulue ou encore l’artiste Martha Maxwell. Qu’elles soient fantasmées, caricaturées, réelles ou exagérées, les représentations de ces activités ont joué un rôle important dans la construction de l’image de ces créatrices. Il s’agira de voir comment le topos de l’artiste en dompteuse ou en chasseresse a pu être utilisé par les critiques ou les artistes elles-mêmes pour construire de nouvelles mythologies. Et comment la représentation de ces partenariats ou de ces conflits entre femmes et animaux a pu contribuer à la construction de leurs images au xixe siècle, une période où si les hommes sont considérés comme supérieurs aux animaux, la position des femmes dans cette hiérarchie n’est pas toujours aussi évidente.
Thierry Laugée (Nantes Université)
Osa Johnson, une héroïne pour un documentaire animalier
En 1921, le taxidermiste Carl E. Akeley proposa la création d’un service de « Motion pictures » à l’American Museum of Natural History (New York). Pour l’inaugurer, une mission d’acquisition d’images en Afrique occidentale britannique fut confiée à Martin (1884-1937) et Osa Johnson (1894-1953).
Afin de financer cette mission, le muséum choisit de recourir à une souscription et, pour encourager les investisseurs, fit publier une brochure explicitant les raisons du choix de Martin Johnson. La première raison évoquée est l’expérience dans ce domaine ; Martin Johnson avait déjà tourné en Afrique. Mais le rapport indique surtout que Martin Johnson, contrairement à bon nombre de cinéastes, porte une attention singulière à la beauté de la faune africaine, et l’aide du muséum devait lui permettre de réaliser un film majeur du point de vue de la science comme de l’éducation. Ce film fut annoncé comme un projet de conservation d’urgence par l’image. S’écrivaient alors les premières normes du documentaire animalier. Les films de Martin Johnson devaient être vrais, sans aucune mise en scène, et sans sensationnalisme.
Dès la brochure, le rôle de Mme Johnson est présenté comme un atout pour son mari. Au fil de l’expédition, Mme Johnson acquiert un prénom, Osa. L’apparente contradiction entre sa féminité et la faune sauvage devient un produit médiatique. Dès les premiers rapports rédigés par Martin Johnson, la direction du Muséum réalise combien Osa Johnson est l’héroïne de l’aventure. Son visage est celui de l’entreprise, au point d’éclipser son époux. Cette intervention présentera le rôle officiel d’Osa Johnson en tant qu’héroïne de documentaire animalier, et permettra d’identifier des formes genrées de la sensibilisation à la faune sauvage.
Katherine Fein (Columbia University, New York, États-Unis)
Intimités transatlantiques : Sarah Goodridge et les éléphants d’Afrique
Dans le Boston du début du XIXe siècle, Sarah Goodridge est une grande miniaturiste réputée. En d’autres termes, elle gagne sa vie en peignant de riches mécènes blancs sur des pièces d’ivoire issu d’éléphants d’Afrique. Dans les études des miniatures, l’éléphant n’est presque jamais mentionné, alors même que c’est la matérialité unique de ses défenses qui permet la représentation lumineuse de la peau blanche si convoitée dans ces portraits. Mon article vient rectifier cette omission : je situe les peintures sur ivoire de Goodridge dans un contexte global de commerce, de chasse et d’esclavage, faisant le lien entre des miniatures à Boston et des éléphants d’Afrique, à quelque 8 000 kilomètres de là. À travers des écrits de miniaturistes, des articles de presse et des journaux d’expédition, j’expose les réseaux d’échange et d’exploitation transatlantiques qui ont amené des morceaux de défenses d’éléphants d’Afrique dans les mains de Goodridge.
Ce faisant, je complexifie la vision populaire de la miniature comme portrait intime. Les historiens de l’art ont décrit la façon dont ces objets haptiques documentaient et cultivaient l’intimité à travers des rencontres privées et affectives entre sujet et spectateur. Outre l’intimité entre personnes, je vois dans cet objet l’intimité hasardeuse entre espèces. Mon analyse révèle comment le geste romantique de Goodridge reposait sur des violences infligées aux éléphants d’Afrique, rompant ainsi leurs affinités. Bien qu’aujourd’hui les écrits n’en fassent pas mention, je démontre que Goodridge devait être au fait de ces violences, non seulement par les représentations textuelles et visuelles des éléphants, mais aussi par ses rencontres personnelles avec des éléphants. Enfin, j'insiste pour que l’on regarde – au lieu de voir à travers – l’ivoire lumineux des portraits de Goodridge tout en tenant compte de l’imbrication des vies humaines et des éléphants au début du XIXe siècle.
Emmanuelle Fantin et Sophie Corbillé (Celsa Sorbonne Université, Neuilly-sur-Seine)
Pourquoi regarder les animaux aux Expositions universelles de Londres et de Paris (1855-1889) ?
AuXIXe siècle, les animaux font une entrée fracassante dans la culture visuelle. Ils sont exposés, regardés, représentés, et sont ainsi, aux côtés des humains, pris dans la pulsion scopique qui caractérise le siècle : dioramas, miniatures, jouets, peintures animalières, spectacles au cirque, à l’hippodrome ou dans les théâtres, à l’aquarium, etc. Parmi ces innombrables dispositifs de monstration, on trouve également les Expositions universelles, cependant peu étudiées sous cet angle. Gigantesques mises en scène des progrès industriels et du pouvoir des nations, vitrines du colonialisme en marche, mais aussi foires commerciales glorifiant la toute-puissance de la marchandise, les Expositions universelles constituent des pivots de l’étude des mutations culturelles, politiques, économiques et esthétiques propres au XIXe siècle. Comment les animaux y sont-ils présentés et mis en scène ? Vivants, naturalisés, peints, en morceaux ou en miettes ? En quoi les Expositions universelles participent-elles à leur (re)qualification ? Le désir d’ordonnancement et de classification conditionne en effet fortement leur présence, les animaux sont tour à tour catégorisés comme domestiques, de rente, nuisibles, coloniaux, etc. En quoi les Expositions contribuent-elles à la fabrication de nouveaux rapports entre humains et non humains ? Enfin, comment l’exhibition des animaux les transforme-t-elle en « acteurs-objets » au service du capitalisme en expansion, sous l’égide de la « modernité », du « progrès » et de la colonisation ?
À partir de l’analyse des catalogues et guides des Expositions universelles de Londres et Paris entre 1851 et 1889, cette communication explorera les liens entre la naissance d’une nouvelle culture visuelle animalière et ces dispositifs, étant entendu que « la culture visuelle n’est pas un ensemble d’images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisées par ces images ». Pour le dire autrement, ces Expositions participent non seulement à une économie large du « dressage » animal, mais aussi du regard humain. Boidy formule avec une grande limpidité la question : « Comment les individus regardants sont-ils dressables au même titre que les individus regardés ? » L’analyse de ces événements est d’autant plus intéressante qu’ils rassemblent une vaste palette de dispositifs d’exhibition, renouvelant à chaque fois le rapport à l’animal qui est instauré.
Cette communication aura donc pour objectif de proposer un cadrage plus vaste sur l’un des contextes d’exposition des œuvres de Rosa Bonheur, dont la présence renouvelée aux Expositions universelles a permis de faire circuler et de consacrer son travail, comme en témoigne la médaille de première classe qui lui fut décernée à la toute première exposition parisienne de 1855.
Kate Nichols (University of Birmingham, Royaume-Uni)
Raconter : biographies de grands félins, réseaux impériaux britanniques et œuvres de Briton Rivière
Les études des animaux nous encouragent à explorer la présence active des animaux dans le monde et leurs rôles formateurs au sein des récits historiques. Vue sous cet angle, la question n’est pas seulement de savoir comment les animaux sont représentés dans l’art – les moyens établis par lesquels les histoires de l’art animalier ont été étudiées –, mais comment ils contribuent à l’art. Dans cet article, je propose un moyen d’aborder cette problématique en regroupant des biographies spéculatives de grands félins tirées des archives du Zoo de Londres portant sur des animaux qui apparaissent dans les peintures de 1870 à 1890 réalisées par celui qui se présentait comme l’« héritier de Landseer » : Briton Rivière (1840-1920).
Mes questions sont les suivantes : Comment ces animaux sont-ils parvenus dans leurs enclos du Zoo de Londres, où Rivière les a dessinés ? Dans quel rapport humains-animaux s’inscrivaient-ils dans leur lieu d’origine ? Quels sont les réseaux d’agents humains et non humains qui leur ont permis d’apparaître sur les toiles ? Comment Rivière interagissait-il avec eux au sein du zoo ? Et comment ces connaissances transforment-elles notre lecture de ces œuvres ?
Réfléchir à la présence de ces animaux replace ces tableaux, qui relèvent en grande partie de l’antiquité classique, directement dans les circuits de la gouvernance et de la diplomatie coloniales duXIXe siècle, du commerce, de la famine et des guerres. Cela démontre la vaste étendue géographique – depuis l’Inde, le Népal, les ports ouverts de la Chine, la Malaisie, la Somalie britannique et Zanzibar jusqu’à Londres – via le Canal de Suez – et la grande variété d’écosystèmes et d’acteurs susceptibles de contribuer à resituer l’identité britannique de ces peintures animalières. Aucun de ces récits ne serait visible si l’on ne s’efforçait pas de retracer les interactions violentes entre humains et animaux sur lesquelles reposent ces images.
Annie Ronan (Virginia Polytechnic Institute, États-Unis)
Un artiste animalier afro-américain dans la fosse aux lions : race, espèces et visualité coloniale dans les études animalières de Henry Ossawa Tanner
Avant d’acquérir sa renommée internationale pour ses scènes bibliques, Henry Ossawa Tanner (1859-1937) s’était spécialisé dans l’art animalier. Sa dévotion pour ce genre a alimenté son parcours scolaire à l’Académie des beaux-arts de Philadelphie, ainsi que sa formation à Paris et son premier grand succès au Salon. Contrairement aux écrits existants, qui écartent les œuvres de ses débuts de carrière au rang de simples futilités, cet article avance que l’œuvre Daniel dans la fosse aux lions de Tanner datant de 1895 constitue sa critique la plus marquée de la politique de l’apparence, de la politique raciale et de la relation entre les deux.
Le tableau de Tanner réimagine la prison de Daniel comme une ménagerie moderne. Puisant dans son étude complète des lions au Zoo de Philadelphie et au Jardin des plantes de Paris, Tanner évoque le traumatisme de la captivité et de la représentation publique ininterrompue. Dans les zoos publics fréquentés par l’artiste, les animaux étaient présentés comme des démonstrations de la rectitude coloniale et comme un moyen d’affiner les pratiques de classification typologiques, qui étaient à l’époque considérées comme la prérogative exclusive de l’observateur blanc. En tant qu’homme métis vivant à la fin du XIXe siècle en Amérique, et en tant qu’artiste dont les œuvres ne pouvaient jamais être abordées sans analyse physionomique des « indices de ses origines africaines », Tanner était douloureusement conscient de l’application de ces pratiques de discernement visuel aux êtres humains autant qu’aux animaux. Contrecarrant avec insistance les habitudes visuelles traditionnellement cultivées par le zoo, la revisite radicale de la fosse aux lions présentée par Tanner invite le spectateur à interroger son propre investissement dans la douleur, les plaisirs et le pouvoir du regard classificateur.
Michel Pons (musée de l’atelier de Rosa Bonheur)
Rosa Bonheur et son rapport aux animaux
Dès son plus jeune âge, Rosa Bonheur éprouve « un attrait irrésistible » pour les animaux. Cet attrait se manifeste d’abord pour ceux des campagnes de l’Île-de-France puis pour ceux de la forêt de Fontainebleau ; plus tard pour les fauves. Elle manifeste en outre une grande curiosité pour les races qu’elle découvre aux cours de ses voyages.
L’amour que l’artiste porte aux animaux de sa « ménagerie » est quasi maternel ; elle veille personnellement aux soins de tous ses animaux.
Membre de la Société protectrice des animaux, elle s’est révoltée contre la maltraitance des chevaux (Le Marché aux chevaux, Le Limonier).
Chasseuse, Rosa Bonheur ne tirait que le lapin pour l’alimentation de sa maisonnée. Mais elle a suivi des chasses à courre : on connaît quatre études de scènes de poursuite, mais, dans ses « œuvres achevées », elle n’a représenté que des rendez-vous de chasse.
Quasi autodidacte, Rosa Bonheur n’a « eu pour professeurs que [son] père et la grandiose nature ». Elle a étudié seule « tous les types d’animaux au triple point de vue myologique, ostéologique et physiologique ».
Grâce à ses marchands de tableaux, ses œuvres ont été diffusées en Angleterre puis aux États-Unis. Les estampes ont joué un rôle essentiel dans cette diffusion.
Après avoir connu la misère dans son enfance, Rosa Bonheur a vécu de sa peinture : « Tout ce que je possède, je ne le dois qu’à mon travail » dira-t-elle à la fin de sa vie.
Estelle Zhong Mengual (École nationale supérieure des beaux-arts de Paris)
L’œil relationnel de Rosa Bonheur pour les animaux
COMMUNICATION ANNULÉE
Face aux représentations d’animaux non humains, deux cadres d’interprétations dominent. Dans le cadre d’interprétation descriptif, les qualités picturales mises en exergue relèvent des effets illusionnistes : c’est la virtuosité technique du peintre, l’imitation de notre expérience visuelle qui sera remarquée. Les animaux existent alors dans l’attention du regardeur comme corps anatomiques exacts. Dans le cadre d’interprétation expressif, c’est à l’inverse la capacité de l’œuvre à exprimer une intériorité animale qui sera mise en avant. C’est alors la psychologie des animaux qui retient l’attention : leur capacité à signifier un état émotionnel que le regardeur associe à une individualité animale. Ces deux cadres ont été abondamment mobilisés pour interpréter l’œuvre de Rosa Bonheur. Néanmoins, certains tableaux échappent à ces manières de prêter attention aux animaux représentés, notamment lorsqu’il s’agit de scènes de vie mettant en scène des animaux d’élevage, comme les vaches et les brebis. Quel visage des animaux nous est restitué par l’artiste quand elle peint ces vaches qui traversent un loch ou ces moutons paissant dans une prairie, qui n’est ni une intériorité psychologique, ni une description anatomique ? Quelle part d’invisible de ces êtres nous donne-t-elle à voir grâce à son œil tout entier façonné par le compagnonnage et l’élevage – autrement inaccessible pour qui n’a pas l’œil, c’est-à-dire, pour qui est sans relation aux animaux ? La pratique picturale de Rosa Bonheur met en évidence à quel point l’œil est relationnel : ce que nous voyons des animaux dépend des pratiques que nous avons à leur égard.
Katie Hornstein (Dartmouth College, États-Unis)
Rosa Bonheur, François Bidel et le spectacle de la captivité des lions
Il est notoire que Rosa Bonheur a fait à deux reprises l’acquisition de lions pour sa ménagerie personnelle, dans sa propriété de By. En revanche, on en sait moins sur sa relation avec François Bidel, le dompteur de lions qui lui a offert ses lionceaux. Bidel a décrit sa proche amitié avec Rosa Bonheur dans ses mémoires et auprès de journalistes, et a consolidé cette relation en lui offrant ses lionceaux. À la fin des années 1870, Bidel avait amassé une fortune suffisamment conséquente pour s’offrir une propriété dans la banlieue moderne d’Asnières. Il l’avait baptisée la Villa des Lions, une propriété presque littéralement bâtie sur l’exploitation et la captivité des lions que Bidel gardait dans sa ménagerie. En plus des décorations extérieures et intérieures de sa villa, axées sur le thème du lion, Bidel possédait un double portrait de ses deux lions signé Rosa Bonheur. Dans cet article, j’analyse le tableau et j’identifie les deux lions représentés comme étant les plus célèbres lions de Bidel, Sultan et Saïda. Parallèlement à une étude de la célébrité des deux lions représentés, je postule également que ce tableau a servi d’étude à l’huile pour la composition grand format de Bonheur intitulée Le Lion chez lui. Ces perspectives me permettent de poser des questions sur les illusions que véhiculent les représentations animalières, ainsi que sur les enjeux écologiques de la réception de tableaux tels que Le Lion chez lui.
Valérie Bienvenue (université de Montréal, Canada)
Par respect pour cet « Autre », le cheval. Le caractère hospitalier de l’art de Rosa Bonheur
Dès le XIXe siècle, Rosa Bonheur exhibe un art charnière qui offre l’assise pour constater de nombreuses tentatives de communications interespèces, à l’intérieur et à l’extérieur du cadre de sa peinture. Cette présentation, particulièrement intéressée par l’étude de certaines œuvres de Bonheur représentant des chevaux, s’applique à exposer que la maestria de l’artiste dépasse les « simples » techniques picturales et se caractérise plus globalement par ses capacités hors normes à témoigner, avec finesse, de diverses relations. L’observation attentive de l’art de Bonheur devient dès lors une invitation ; une porte d’entrée pour réfléchir les rouages d’une éthique de la représentation équine, sous le prisme du concept innovant de l’hospitalité interespèces. Les mots « accueillir », « hôte », « étranger », « générosité », « demeure », « loger », « héberger », « asile », « hostilité », « offrir » et « recevoir » sont des exemples parlants de la sémantique liée à l’hospitalité et inhabituels pour l’histoire de l’art. Cependant, lorsqu’ils sont insérés dans le giron des réflexions en liens avec les relations entre humains et animaux ils éclairent d’une lucidité nouvelle d’inévitables variations de considération entre humains (public, historiens, critiques, artistes, conservateurs) et non humains. L’hospitalité de type interespèces commande de revisiter les mécanismes réflexes de tout exercice de « capture » (voir, dire, écrire, peindre) de cet « Autre », l’animal non humain, ici le cheval, pour se conscientiser à des responsabilités premières, relevant de l’éthique. Cette communication souhaite inspirer un long processus ; celui de repanser des histoires interespèces, personnelles et institutionnelles, pour les réécrire de façon plus inclusive et davantage bienveillante.
Oriane Poret (université Lumière Lyon 2)
« A kind of mesmeric power » ou Ce que disent les écrits et les images du rapport de Rosa Bonheur avec les animaux
Alors que l’actualité s’enrichit autour de Rosa Bonheur et s’intéresse à son œuvre aussi bien qu’à ses écrits, nous souhaitons mettre en perspective les réactions de ses contemporains sur la question de son rapport aux animaux. En présentant les résultats d’un travail d’identification de la constellation animale autour de l’artiste, notre intervention s’intéressera à l’aspect du care et du contrôle (« mesmérique » ?) dans les rapports de Rosa Bonheur à ses animaux. Amatrice de chasse et mangeuse de viande, l’artiste vit avec son siècle et s’attèle à la création d’un microcosme à une époque où le macrocosme est refusé aux femmes. Nous souhaitons présenter spécifiquement certaines étapes : la « chasse » aux sujets animaliers, parfois orchestrée par le biais des voyages, la « collecte » de modèles pour les besoins de son art et le traitement de la mort animale, par le dessin ou la taxidermie. Du licol au labyrinthe de bois, en passant par l’apprivoisement progressif, quels ont été les stratagèmes de l’artiste pour apprendre à vivre avec la réalité animale et s’en saisir dans son art ? De quels statuts sont dotés les animaux entrant au service de la peintre ? Pour mettre en avant la manière avec laquelle l’artiste a développé une intimité avec les animaux – entre modèles et compagnons de vie – nous souhaitons confronter les écrits de la presse contemporaine, anglo-saxonne notamment, les œuvres et ce que nous savons de la réalité de cette intimité.
Maître Ambroise Colombani (Cabinet d’avocats Colombani Semmel)
La loi Grammont pour défendre les animaux
Rosa Bonheur est sans conteste la plus célèbre des peintres animalières du xixe siècle. Parallèlement à cet intérêt pour la représentation animale et à la place centrale qu’occupent, à la même époque, les sciences naturelles, on assiste à l’apparition d’une nouvelle conception des relations homme/animal. C’est dans ce contexte – la Société de défense des animaux (SPA) est créée en 1845 – que s’inscrit la loi Grammont de 1850. Je propose de décrire les avancées que cette loi a permis d’accomplir pour la protection des animaux et le lent mouvement qu’elle initie jusqu’à la reconnaissance, très récente, des animaux comme « étant des êtres vivants et sensibles ».
Éric Baratay (université Jean Moulin Lyon III)
Une autre Rosa : Séverine, écrivaine, artiste, militante animaliste, féministe, socialiste
Caroline Rémy (1855-1929), surnommée Séverine, est une figure célèbre du journalisme militant entre la fin du xixe siècle et les années 1920. Lorsqu’elle publie Sac-à-tout, mémoires d’un petit chien, texte et illustrations de Séverine en 1903, elle se fait écrivaine, inventant l’histoire fictive d’un chien qu’elle a recueilli mais dont elle ignore le passé, et artiste photographe, parsemant l’ouvrage de clichés aux poses élaborées, assez théâtrales, illustrant le récit et mettant en scène des humains et des animaux, la vie extérieure et la sphère privée. S’inscrivant dans le courant littéraire des biographies et autobiographies animales, né à la fin du xviiie siècle en Angleterre puis en France, illustré par des ouvrages célèbres, tels les Mémoires d’un âne de la comtesse de Ségur, cette œuvre permet à Séverine d’exposer ses préoccupations et sa vision du monde. En premier lieu, son intérêt et ses combats pour les animaux, un aspect oublié ou négligé de nos jours (l’article Wikipédia l’occulte totalement) alors qu’il avait grandement participé à la célébrité de Séverine, notamment en s’opposant, vainement, à l’implantation de la corrida en France. Le récit concernant Sac-à-tout permet ainsi d’évoquer la dure condition des chiens urbains, en particulier des errants. Cependant, les autres combats de Séverine sont aussi évoqués : la condition des femmes, qui la conduit à collaborer au journal La Fronde de Marguerite Durand autre figure conjuguant féminisme et « animalisme », à l’origine du premier cimetière pour chiens, à Asnières-sur-Seine ; la pauvreté et l’enfance malheureuse, qui la rendent proche de Jules Vallès puis des communistes après-guerre ; les erreurs judiciaires, qui la conduisent à prendre parti pour Dreyfus. Séverine incarne une défense des opprimés mise en scène par Hugo ou Zola et une ligne féminine proche de celle de Rosa Bonheur.
Diane Bouteiller (architecte du patrimoine)
La forêt de vènerie : un cadre privilégié et d’inspiration pour Rosa Bonheur
Si la forêt est une source d'inspiration pour Rosa Bonheur qui s'est installée en lisière du domaine de Fontainebleau, elle est également un terrain de chasse pour les veneurs. Époque faste pour la vénerie, le XIXe siècle est en effet marqué par la constitution de nombreux équipages et par la démocratisation des pratiques cynégétiques. Bien qu'elle ne chasse pas, c'est dans cet environnement que l'artiste peint des équipages, des chiens, des chevaux ou encore des cervidés et des sangliers.
Quelques-unes de ses toiles étonnent tant elles contrastent avec la réalité du contexte forestier de l'époque. Les animaux sont parfois représentés au milieu d'une nature sauvage, dans des ambiances obscures ; pourtant, ces espaces sont maîtrisés et aménagés par l'homme. Le XIXe siècle voit la construction de multiples architectures spécifiques et les massifs forestiers, leurs écrins, sont percés d'allées pour les besoins logistiques de la chasse. Dès lors, ces forêts ne sont plus considérées comme des lieux hostiles peuplés par une faune menaçante mais comme le théâtre des pratiques de vénerie et des loisirs associés à la villégiature.
Dans l'atelier du château de By de Rosa Bonheur, les décors issus du vivant – notamment les massacres et les animaux naturalisés – occupent une place privilégiée. Bien qu'ils ne soient pas des trophées de chasse, ils semblent reprendre les mêmes techniques de taxidermie et les mises en scène des salles de réception et de « débotté » des rendez-vous de chasse.
L'intervention propose de montrer le paradoxe entre quelques décors idéalisés par l'artiste animalière et la réalité des pratiques de l'époque qui façonnent la forêt et les constructions dédiées. Au travers d'une approche prospective sur notre projet de thèse – qui traite des pratiques cynégétiques dans la fabrique de l'architecture et du paysage en France au XIXe siècle –, nous présentons un autre regard sur le cadre de vie de Rosa Bonheur, une « nature » éprouvée par l'homme et les animaux, représentée par les artistes et structurée par les activités humaines.